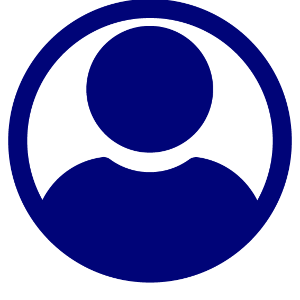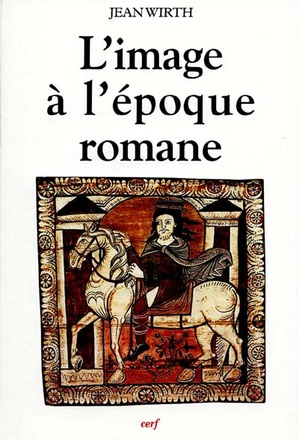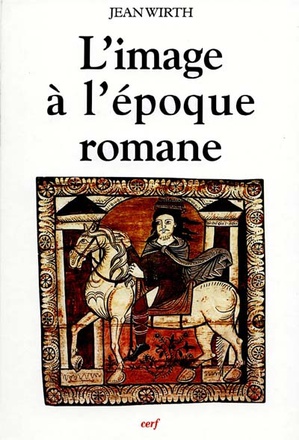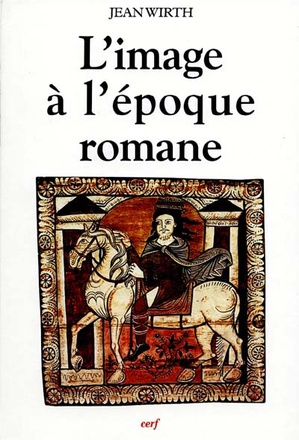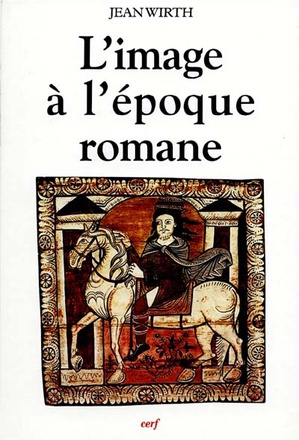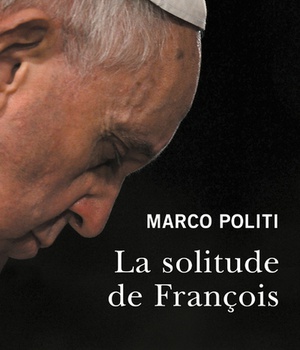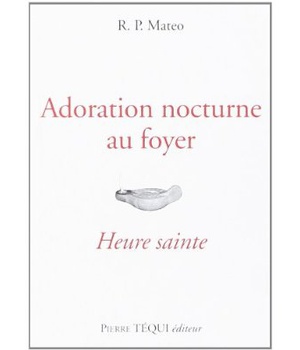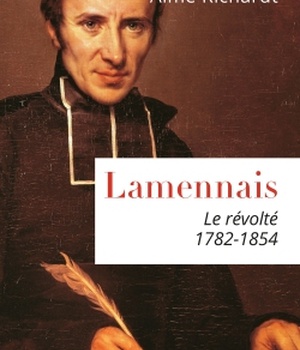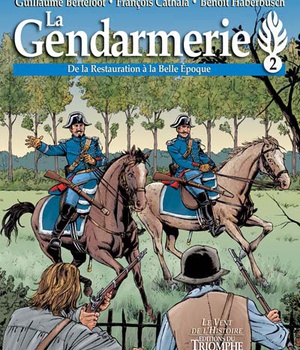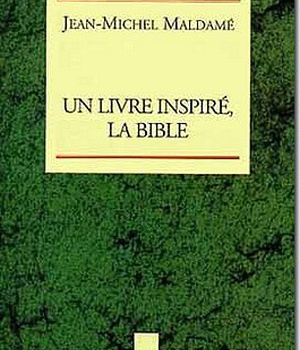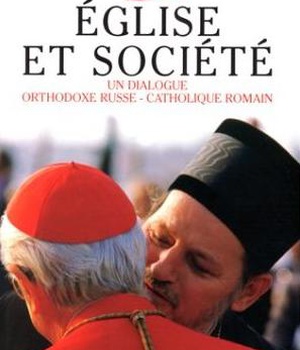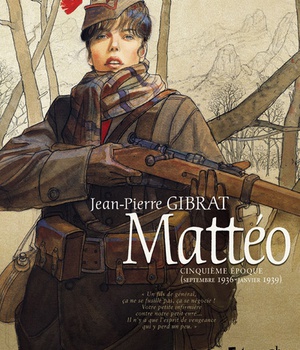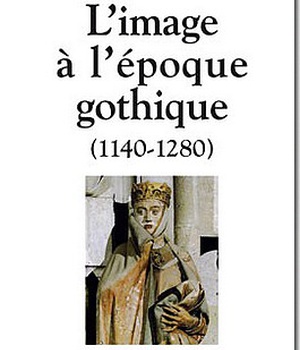L'IMAGE A L'EPOQUE ROMANE
WIRTH JEAN
CERF
Résumé :
Ouvrage publié avec le soutien du Fonds national suisse de la recherche scientifique et du Fonds général de l'Université de Genève
Depuis « L'Art religieux du XIIe siècle en France » d'Émile Mâle
En remontant jusqu'à l'époque carolingienne, il étudie d'abord la formation des codes iconographiques romans, des moyens dont les artistes se sont dotés pour représenter le spirituel pourtant considéré comme invisible. Il dégage ensuite les traits caractéristiques de la production du XIe siècle avant la réforme grégorienne, ce qui l'amène à corriger la datation de monuments importants. Dès lors apparaît clairement la rupture constituée par la réforme de l'Église qui impose une représentation terrifiante de la vie selon la chair et promeut l'ascétisme le plus extrême, tout en donnant une impulsion sans précédent au luxe artistique. Une nouvelle rupture intervient dans les années 1120, avec l'échec de la théocratie pontificale. On assiste alors à un assouplissement du style et à une réhabilitation de la figure humaine.
Jean Wirth montre donc que le monde des images romanes, loin de se répéter inlassablement et de reposer sur un symbolisme intemporel, évolue avec une rapidité saisissante. Son ouvrage, fondé sur une démarche pluridisciplinaire qui prend en compte les exigences de l'histoire politique, de l'histoire de l'art, de la religion et des idées, devrait réorienter durablement le travail des spécialistes. De plus, il offre à un public plus large les informations nécessaires au déchiffrement des œuvres.
Jean Wirth, ancien élève de l'École des chartes, est professeur d'histoire de l'art du Moyen Âge à l'université de Genève. Spécialiste de l'image médiévale, il est l'auteur d'importants travaux qui se caractérisent par un égal intérêt pour les problèmes traditionnels de l'histoire de l'art et pour l'étude des systèmes de représentation.
ntroduction
7
PREMIÈRE PARTIE
LA SACRALISATION DES IMAGES
Chapitre premier. L'Église et le siècle
17
Le christianisme occidental vers l'an mille
18
La religion du livre
18
Les faiblesses du système
20
Le temps des réformes
22
La clôture monastique
22
Le problème des suffrages
24
Chapitre II. Les images
27
Qu'est-ce qu'une image ?
27
« Imago » et « historia »
28
Le décor peint et sculpté
29
La définition augustinienne de l'image
32
La nature de l'icône
34
Image et spirituel
35
L'adoration des images
40
La transitivité de l'adoration
41
Consacrer les images ?
44
Renaissance de l'image d'adoration
46
La majesté du Christ
46
La croix
50
Les reliquaires anthropomorphes
52
La Vierge à l'Enfant
57
Chapitre III. Le travail iconographique
61
Les artistes
61
Une faible spécialisation
62
Un niveau intellectuel élevé
63
La copie et l'invention
66
L'écriture de l'image
72
La représentation de l'invisible
73
Les procédés syntaxiques
80
Les procédés sémantiques
87
Iconographie et liturgie
95
L'interprétation liturgique de la vie du Christ
96
L'église comme paradis
100
DEUXIÈME PARTIE
L'ÉCLIPSE DE L'ICONOGRAPHIE
Chapitre premier. La crise de la figuration
109
Le déclin de la narrativité
109
Le primat de l'image
110
Le déclin de l'organicité
114
La richesse du décor
115
La « split representation »
116
Le mode de projection
117
L'adoption de la « split representation »
119
Chapitre II. Ascétisme et paganisme
125
Une nouvelle attitude religieuse
125
La fin du rationalisme carolingien
126
L'attraction du présent
128
Un paganisme médiéval ?
130
Le témoignage de Burchard de Worms
131
L'éclipse de lune
132
Du mythe à l'image : le femme de l'Apocalypse
134
L'interprétation mariale de la femme de l'Apocalypse
134
La double lecture
137
De l'image à la légende : la préhistoire de Mélusine
140
La sirène à queue de poisson
141
Mélusine et les sirènes
146
« Fée » et « féer »
151
Mozat, Brioude et Chanteuges
154
Le problème de datation
158
Le répertoire iconographique
163
La signification des images licencieuses
169
Chapitre III. La restructuration de l'image
173
Le creuset de l'ornement
173
L'initiale ornée
174
Le rinceau et la palmette dans le décor monumental
175
L'incorporation de l'image dans le monument
179
L'image et le champ
183
La notion de champ
183
La constitution du champ
186
TROISIÈME PARTIE
LA RÉFORME GRÉGORIENNE
Chapitre premier. Faire le dieu
195
La présence réelle
195
Dieu comme chose
196
L'eucharistie
197
Sacrifier son Dieu
200
L'eucharistie et l'acte de chair
200
Les pouvoirs du prêtre
202
Le sacrement de la communauté
203
Les conflits
206
Chapitre II. La glorification de l'Église
209
La figure du Christ
214
L'identification totale du Christ à Dieu
214
L'assimilation du Christ historique et sacramentel
218
Le Christ et le monde
221
La représentation de l'Église
225
Les pouvoirs de saint Pierre
227
L'Épouse
230
Les anges
236
L'Église dans l'histoire
239
Une apparente indifférence à l'histoire
240
L'histoire du salut
248
Chapitre III. Luxe et mépris du monde
257
Le dualisme chrétien
257
La haine de la chair
260
Caractère limité du refus de l'art
263
Théologie de l'idole
265
La chair et l'esprit
272
Le problème de l'homme nu
273
Les métaphores de la chair
277
La réinterprétation des thèmes profanes
286
Les œuvres
303
Le souvenir du fondateur
303
Avarice et luxure
308
Signatures et portraits d'artistes
313
La nature et l'art
317
Les chapiteaux de Notre-Dame-du-Port
321
QUATRIÈME PARTIE
INCARNATION ET IMAGE
Chapitre premier. Les limites de la réforme
333
Le programme non réformé de Zillis
333
Le contexte
336
L'état du plafond
338
Le programme iconographique
340
Le refus de l'affrontement
353
Le rejet du dualisme dans l'hérésie
361
De l'angélisme à l'Incarnation
362
Le retour de la ressemblance
365
L'image du Dieu incarné
370
« Deus artifex »
372
Chapitre II. Le nouveau symbolisme
379
Ce que peignent les théologiens
379
La signification des choses
380
Le « Libellus de formatione arche » de Hugues de Saint-Victor
382
Le « Liber Scivias » de Hildegarde de Bingen
394
La dimension historique du salut
410
Le déploiement de l'histoire humaine
412
L'arbre de Jessé
416
Le Christ, la Vierge et la communauté
423
Les commentaires du Cantique des Cantiques
426
La Vierge remplace l'Église comme Épouse du Christ
430
L'intercession mariale
441
Conclusion
451
Bibliographie
457
Index des noms de personnes et de lieux
473
Liste des illustrations
485
Table des matières
CARACTÉRISTIQUES
| Catégorie | Livres | Date de parution | 20 septembre 1999 | EAN | 9782204060868 |
| Auteur | WIRTH JEAN | Éditeur | CERF | Format | 173.0 mm 244.0 * |
| Poids | 1272.0 g | Prix TTC | 55.2 € | EAN | 9782204060868 |
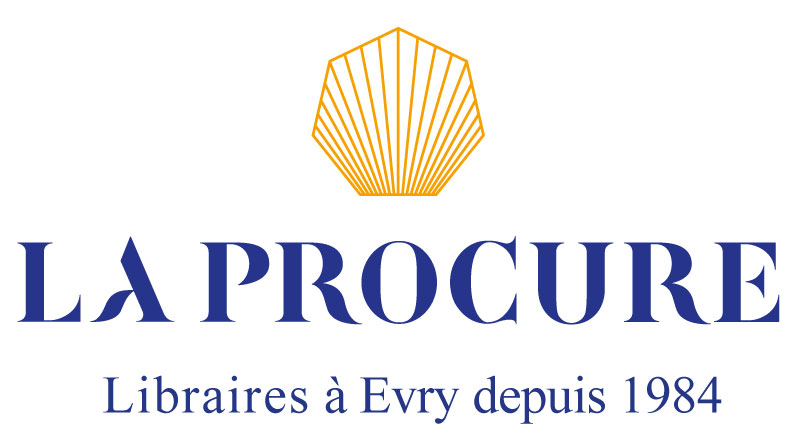
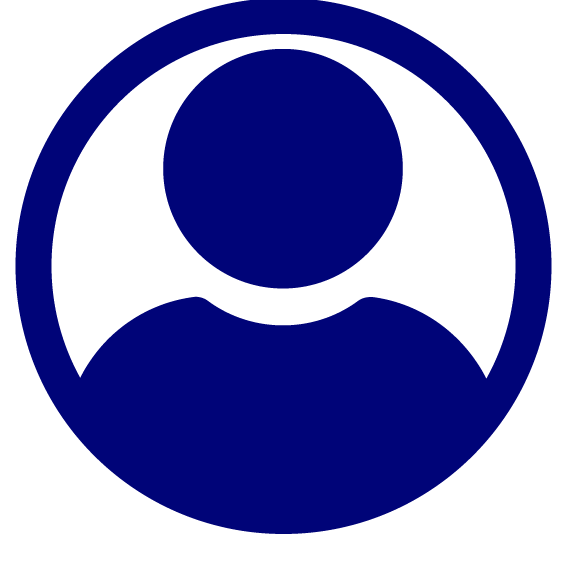 Se connecter
Se connecter